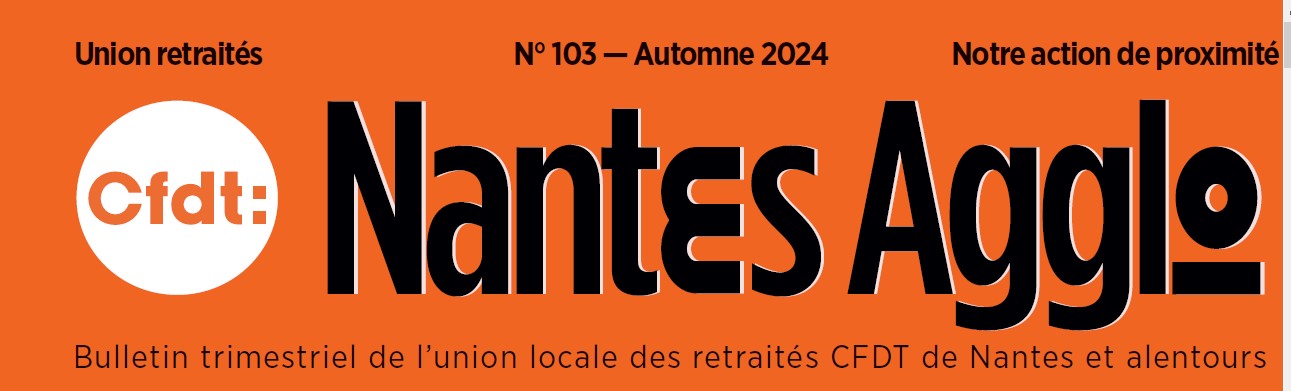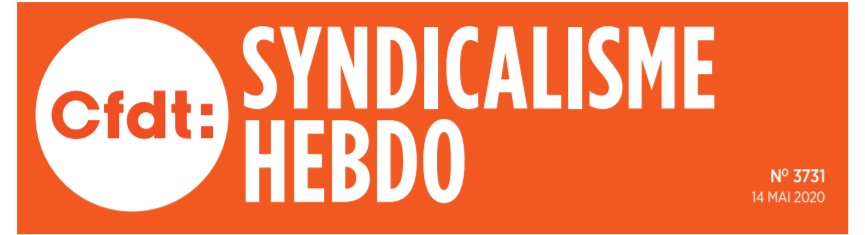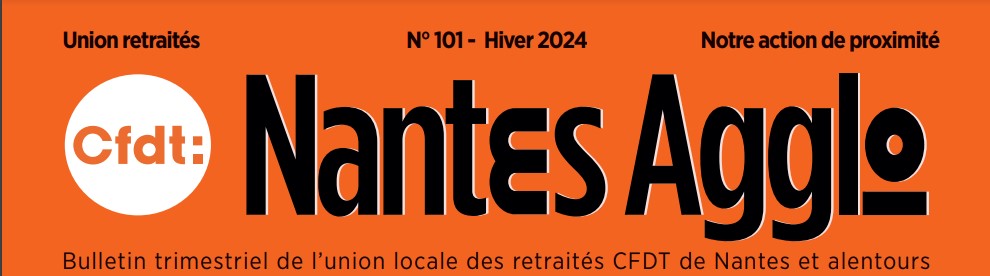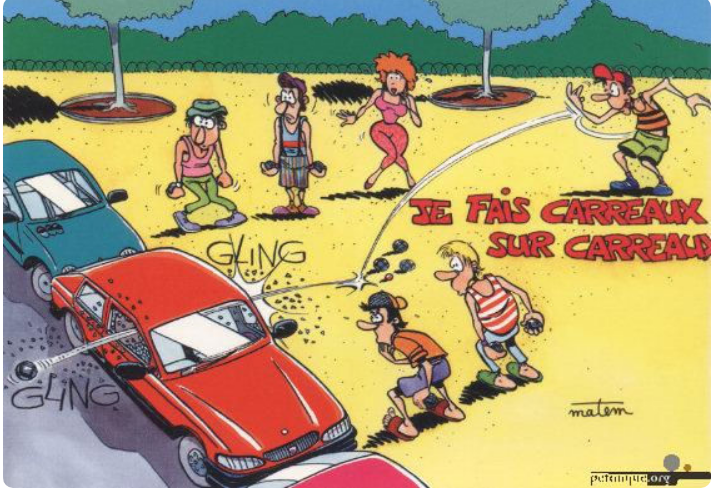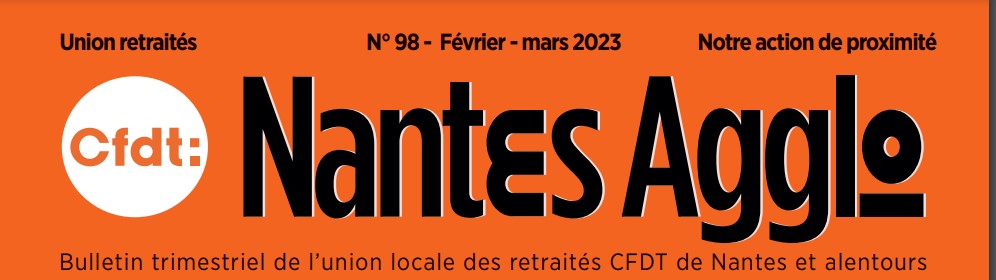Journée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...

DÉCLARATION DE PHILIPPE PORTIER, SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA CFDT
Vers une transition écologique juste La Convention citoyenne pour le climat au terme de plus de 9 mois de travaux, a remis ce week end ses 150 propositions à la Ministre de la transition écologique.
La CFDT salue la qualité de ses travaux et propositions qui montre à quel point la démocratie est un exercice complexe et exigeant, mais riche et utile. Les propositions formulées vont globalement dans le bon sens.
La CFDT y retrouve nombre de ses revendications, ainsi que des propositions portées par le Pacte du pouvoir de vivre. L’exécutif doit maintenant apporter des réponses à la hauteur de l’engagement des 150 citoyens. Le temps de l’action est venu c’est pourquoi la CFDT sera vigilante à la mise en œuvre des propositions, en particulier sur :
‐ L’obligation de rénovation des passoires thermiques à l’horizon de 2040. Pour la CFDT, la lutte contre l’habitat indigne et la rénovation énergétique des bâtiments constituent une priorité absolue. C’est un chantier prioritaire à intensifier bénéfique pour l’environnement, le pouvoir d’achat, l’emploi et la santé. Il faudra tout particulièrement veiller à la mise en place de l’accompagnement tant des ménages que des travailleurs dans cette transformation d’ampleur.
‐ Le déploiement d’un plan de mobilités durables ambitieux. Le développement des transports en communs, l’amélioration des trajets domicile-travail des salariés et agents, le dialogue sur le télétravail sont des chantiers dans lesquels la CFDT est déjà engagée. La Convention propose de renforcer les normes environnementales des véhicules thermiques (réduction du poids et des émissions de gaz à effet de serre). Ces actions devront nécessairement se doubler d’un accompagnement de la filière automobile, qui emploie des milliers de salariés dans nos territoires.
‐ La relocalisation de productions alimentaires. La CFDT partage la nécessité d’un plan d’investissement pour l’agriculture afin de soutenir les circuits courts, les productions durables, à faible coût environnemental, mais tout en assurant « du social dans notre assiette ». Une alimentation plus durable passe aussi par des emplois de qualité rémunérés à leur juste valeur.
La CFDT se retrouve dans l’essentiel des préconisations formulées par la Convention citoyenne, même si l’atteinte des objectifs pour affronter l’urgence climatique nécessitera de définir de nouveaux jalons.
Il convient maintenant qu’elles fassent l’objet d’une mise en œuvre démocratique, en associant les parties prenantes aux modalités précises, au suivi et à l’évaluation. Nous en appelons à une gouvernance démocratique exemplaire pour ne plus jamais dissocier transition écologique et justice sociale.
En savoir plus AdhérerDes envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

LES 12 PREMIÈRES PROPOSITIONS DE LA CFDT
Temps de lecture : 5 minutes
La boîte à outils est déjà très fournie : CV de site, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale (GPECT), déploiement du CEP, outils de transitions professionnelles, dispositif CLEA… Pour la compléter…. En cette phase de reprise progressive d’activité la priorité est le soutien-maintien de l’emploi : prévenir les suppressions d’emploi et préserver les compétences – l’activité.
- LA CFDT REVENDIQUE UN CADRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE RÉNOVÉ, CONDITIONNÉ À UN ACCORD D’ENTREPRISE MAJORITAIRE ET À DES ENGAGEMENTS DE MAINTIEN DES EMPLOIS
Ce nouveau dispositif d’activité partielle longue durée doit encourager la formation de tous les salariés avec une rémunération à 100 %. Ces formations doivent répondre aux enjeux de développement des compétences en lien avec les évolutions des activités.
Les entreprises doivent être responsabilisées : des engagements fermes de préservation de l’emploi (et pas uniquement de non licenciements) doivent être pris, ainsi que des engagements de modération de versement des dividendes.
Ce dispositif doit être financé par une ressource dédiée (qu’elle soit ou non partiellement financée par le régime d’assurance chômage). - LA CFDT REVENDIQUE LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI PARTAGÉ, NOTAMMENT VIA LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Les GE permettent de créer des emplois à durée indéterminée à temps plein : les salariés
sont mis à disposition des employeurs d’un même territoire, adhérents du groupement. Au-delà de simplifications, l’organisation de ces groupements pourrait être facilitée par la généralisation de centres de ressources régionaux, impliquant les organisations
syndicales et patronales. En complément, les branches professionnelles doivent dans le cadre de leurs prérogatives
de qualité de l’emploi négocier des dispositions favorisant le recours aux groupements d’employeurs. - PÉRENNISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LES INDÉPENDANTS
Le gouvernement a annoncé un accès simplifié et rapide à une indemnisation pour les travailleurs indépendants. Malheureusement, si cet accès n’est plus possible après le mois de juin, un nombre important d’entre eux devront cesser leur activité.
La CFDT demande que cette indemnisation soit prorogée de trois mois au-delà de la période de fin de confinement pour permettre aux travailleurs indépendants de relancer leur activité. Nous parlons ici de 12 % de l’emploi en France pour l’ensemble des travailleurs indépendants et 1,8 million de travailleurs indépendants n’employant pas de salariés. - UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE DES SALARIÉS DES TPE/PME:
DES CELLULES D’ACCOMPAGNEMENT, D’INFORMATION ET DE RECLASSEMENT (INTERENTREPRISES OU PLURI-ENTREPRISES) DANS LES BASSINS D’EMPLOI
L’enjeu de ces cellules est la prévention des difficultés économiques pour maintenir l’emploi, en mobilisant tous les dispositifs d’appui, l’information des salariés et l’accompagnement des parcours professionnels. - L’ANNULATION DES RÈGLES D’ACCÈS AU RÉGIME D’ASSURANCE-CHÔMAGE ET DE CALCUL DES ALLOCATIONS
Cette réforme était profondément injuste lorsqu’elle a été décidée. Son maintien ou son report est aujourd’hui invraisemblable. L’instauration de la dégressivité et le nouveau mode de calcul
du salaire journalier de référence doivent être définitivement abandonnés. L’ouverture des droits dès 4 mois travaillés doit être restaurée : trop de personnes en grandes difficultés restent aujourd’hui à la porte du régime, notamment des jeunes et des personnes en manque de missions courtes, dont les saisonniers.
La CFDT est prête à ouvrir une réflexion tripartite sur le rôle et le sens du régime d’assurance chômage interprofessionnel. - LE RENFORCEMENT DES MOYENS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Outre le maintien de l’offre de services pour les travailleurs alternant les périodes d’emploi et de chômage, cela implique la révision des orientations stratégiques de Pôle Emploi, l’augmentation de la contribution de l’État au budget de Pôle Emploi ainsi que des effectifs,
et le renforcement de l’offre de service pour les reconversions professionnelles. - DES CONTRATS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Dans la période actuelle, les opportunités de transition écologique, numérique et technologique doivent être saisies pour préserver et développer des emplois. Ces contrats de transition doivent permettre de coordonner à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi, l’ensemble des dispositifs collectifs et individuels existants pour créer de l’activité et sécuriser les parcours. Ces contrats de transition doivent anticiper
les transitions professionnelles et les impacts territoriaux. - BOOSTER LES PARCOURS EMPLOIS COMPÉTENCES
La CFDT demande un objectif de 300 000 PEC chaque année, particulièrement au bénéfice des jeunes. De plus, pour sécuriser une meilleure insertion professionnelle des jeunes, il convient de favoriser l’allongement de leur durée (24 mois), et l’accès à une formation
qualifiante, notamment en alternance (y compris la prépa-apprentissage). - EMPLOI DES SENIORS ET RETRAITE PROGRESSIVE OUVERTE À TOUTES ET TOUS
L’aménagement des conditions et des rythmes de travail des seniors, mais aussi le partage de compétences entre jeunes et seniors, sont des enjeux de moyen terme. La retraite progressive doit permettre de liquider sa retraite partiellement et de manière provisoire tout en poursuivant une activité à temps partiel. C’est un des dispositifs de transition emploiretraite qu’il faut encourager en élargissant la retraite progressive aux salariés en forfaits jours et aux fonctionnaires des 3 fonctions publiques. Les employeurs doivent être incités à
promouvoir ce dispositif et les démarches administratives doivent être simplifiées. - PACK JEUNES CFDT : OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À 800 000 JEUNES DE 18 À 30 ANS
La crise a accentué la fragilité de la situation de nombreux jeunes. Ils doivent être plus et mieux accompagnés par le service public de l’emploi ou par le réseau des acteurs de l’accompagnement vers l’insertion ainsi que dans leur accès à l’autonomie. À l’instar de la garantie européenne pour la jeunesse, tous les jeunes entre 18 et 30 ans doivent se voir proposer une offre d’accompagnement de qualité et renforcé pour trouver un emploi, une formation, un apprentissage, un service civique ou un stage d’ici octobre 2020.
Pour cela, l’accès simplifié du RSA aux jeunes doit permettre dans la période de sécuriser leurs parcours. Les dispositifs permettant de lier accompagnement, formation et emploi comme la Garantie Jeunes et le PACEA doivent être allongés pour permettre aux jeunes les moins qualifiés d’être accompagnés vers l’insertion durable. La CFDT revendique une aide spécifique pour les jeunes étudiants qui n’auront pas pu travailler pour subvenir à leurs moyens afin qu’ils n’arrêtent pas leur parcours de formation. Il faut également offrir la possibilité à un plus grand nombre de jeunes de faire un service civique d’ici la fin de l’année et renforcer leur accompagnement en mutualisant dans les territoires une offre « bilan de compétences et orientation ». - DES MESURES POUR L’APPRENTISSAGE
Soutenir l’apprentissage est indispensable pour que la rentrée 2020 permette à autant de jeunes que cette année de bénéficier d’un contrat d’apprentissage. La CFDT est favorable à une aide aux entreprises qui s’engageront à recruter des apprentis. Cela nécessite
néanmoins de réduire les effets d’aubaine. Pour mobiliser les entreprises, il faut que les branches négocient des accords pour soutenir l’apprentissage en tenant compte des situations et stratégies des secteurs professionnels.
La prise en compte de la situation des jeunes est aussi importante. Ce plan de relance pour l’apprentissage doit être l’occasion de relancer le principe de la collecte des offres de contrats d’apprentissage. Il doit aussi prendre en compte les enseignements de la période de crise
sanitaire que nous traversons et doter chaque futur apprenti des moyens numériques lui permettant de suivre une partie de son enseignement à distance. - UN INVESTISSEMENT MASSIF DANS LES COMPÉTENCES
Alors que la crise a accentué les fractures et les inégalités dans le monde du travail, le premier enjeu est de confirmer et de renforcer les moyens du Plan d’Investissement dans les Compétences en direction des publics les plus fragiles et les moins qualifiés.
La CFDT porte deux priorités pour prendre en compte les enjeux de la période : une mobilisation inédite en direction des décrocheurs et un soutien massif à la validation des socles de compétences de base (Cléa et Cléa numérique).
De nombreux secteurs professionnels vont connaître des mutations accélérées, il faut les accompagner et définir un plan de reconversion à la hauteur des besoins.
Ce plan doit s’articuler autour de 2 piliers :
un système d’abondement très développé des comptes personnels de formation, un droit à la reconversion complètement revisité qui prenne en compte les acquis individuels de chaque travailleur.
Le développement des compétences nécessite une adaptation très fine aux besoins du marché du travail dans un environnement géographique particulier. La CFDT souhaite donc une
discussion dans chacune des régions permettant de définir les secteurs professionnels stratégiques à soutenir et les politiques des compétences qui en découlent. Ce plan sera soutenu financièrement par l’État.
Avec ces 12 premières propositions, la CFDT souhaite contribuer
utilement au débat qui doit s’ouvrir. Elles sont destinées à être complétées dans les jours et semaines à venir pour que des solutions concrètes soient apportées aux travailleurs. Cette démarche nécessite l’engagement de tous les acteurs, la CFDT y prendra toute sa part.
Journée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

Temps de lecture : 8 minutes
Jeudi 4 juin, le Président de la République a réuni les organisations syndicales et patronales à l’Elysée pour lancer une mobilisation pour l’emploi.
Le Président a ouvert la réunion en faisant état d’un choc économique et social sans précédent. Il a insisté sur la nécessité de préserver l’emploi et le tissu productif en faisant le choix de l’engagement collectif par le dialogue social dans les entreprises et les branches.
Le Président de la République a ensuite développé 3 sujets :
SUJET 1
L’activité partielle : il a annoncé la création d’un dispositif d’activité partielle longue durée soumis à accords de branches et d’entreprises. D’ici mi-juin les partenaires sociaux sont invités à en définir les paramètres. A défaut d’accord, l’Etat les définira. Il a insisté sur trois sujets complémentaires à travailler : rééquilibrer le rapport donneur d’ordre/sous-traitant par des accords de branche, réguler le travail détaché, prévoir des mesures spécifiques pour les indépendants.
SUJET 2
L’apprentissage : il sera mis en place une aide unique à l’embauche pour maintenir le nombre d’apprentis. D’ici mi-juin, le Gouvernement fera des propositions aux partenaires sociaux, qui sont invités à formuler des propositions pour soutenir l’emploi des jeunes.
SUJET 3
L’assurance chômage : au vu du contexte, le gouvernement veut revoir les règles régissant l’assurance chômage et notamment les règles d’affiliation. D’ici fin juin, les dispositions de la réforme en cours feront l’objet de discussions.
Le Président a terminé son introduction en appelant à la responsabilité partagée de tous les acteurs. Il a appelé les organisations syndicales et patronales à assumer la leur en s’engageant dans ce pacte de confiance.
La CFDT, par la voix de Laurent Berger, est revenue sur la période passée en actant positivement l’activation des mécanismes d’activité partielle et de soutien social. La CFDT a également demandé :
• La fin des mesures spéciales prises dans les ordonnances dès la fin de l’état d’urgence sanitaire pour revenir aux règles antérieures et à de la concertation sociale normale ;
• La nécessité de ne pas oublier les travailleurs en 1ère et 2ème ligne en termes de reconnaissance salariale et professionnelle ;
• La publication urgente du décret permettant la reconnaissance du covid-19 en maladie professionnelle pour les salariés touchés.
La CFDT a ensuite fait part de ses 12 propositions pour « travailler tous, travailler mieux » (en annexe à cette info rapide) et a ajouté les points suivants :
• Les aides à l’apprentissage doivent être des aides à l’alternance et couvrir donc également les contrats de professionnalisation.
• Il faut des mesures spécifiques pour les travailleurs saisonniers.
• Il ne faut pas oublier les travailleurs en insertion en faisant vivre le pacte insertion.
• Il faut aller plus loin au niveau européen sur le travail détaché, notamment dans le secteur des transports.
• Il faut aller plus loin sur la responsabilité des entreprises.
Après la présentation de nos propositions, la CFDT a affirmé sa volonté de s’engager dans une mobilisation sur l’emploi, à condition que cela se fasse dans la transparence, la loyauté et la confiance.
Positionnement des autres organisations syndicales
La CGT s’est montrée peu encline à s’engager. Elle demande un changement de modèle sans en définir les contours.
FO a demandé l’ouverture d’une négociation sur l’assurance chômage entre partenaires sociaux, sans intervention de l’Etat. Elle est favorable aux mesures proposées sur l’activité partielle à condition que les salaires soient augmentés.
La CGC a salué les mesures de chômage partiel prises durant le confinement et s’est engagée à participer aux concertations. Elle a demandé à ce que des contreparties soient imposées aux entreprises qui perçoivent des aides publiques. Elle a demandé l’annulation de la réforme de l’assurance chômage et s’est opposée à des négociations tripartites.
La CFTC appelle à de nouvelles mesures de confiance sur l’emploi et a plaidé pour une montée en gamme, plutôt que la poursuite d’une « stratégie de low cost ». Elle est prête à s’engager dans cette mobilisation collective.
L’UNSA est partante pour un pacte de protection de l’emploi mais a exprimé une vigilance : ne pas revenir au contrat première embauche. Elle est d’accord pour prendre part à des négociations tripartites.
Le MEDEF a salué les mesures de soutien aux entreprises. L’activité reprend mais reste très en deçà de l’année précédente (-20 %). Il demande à ce que le chômage partiel perdure au moins jusqu’à la rentrée. Il est d’accord pour discuter de l’activité partielle de longue durée avec les organisations syndicales et s’est dit prêt à s’engager dans des accords d’entreprise. Il ne plaide pas pour des baisses de salaires. Le Medef a proposé la mise en place d’une aide à l’embauche de jeunes sans impact sur leur salaire. Il a annoncé vouloir jouer le jeu de l’intérêt général en sortant de nos modèles historiques.
L’U2P a rappelé le risque particulier que courent les petites entreprises dans cette crise et a demandé un plan sectoriel pour les indépendants.
La FNSEA a demandé à ce que la loi agriculture et alimentation s’applique.
Réponse du Gouvernement
La ministre du Travail a proposé 4 mesures pour répondre à la forte demande des jeunes en matière d’apprentissage : une prime exceptionnelle à l’embauche des jeunes en CAP jusqu’à bac + 3 (3 500 euros pour les moins de 18 ans et 8000 euros pour les autres) ; l’engagement des entreprises de plus de 250 salariés à atteindre 5% d’apprentis ; la possibilité pour les jeunes qui n’auraient pas trouvé d’entreprises de rester 6 mois de plus en CFA ; une mobilisation dans les territoires pour aider les jeunes à trouver un emploi par la création d’une plateforme des demandes et un soutien numérique pour les jeunes apprentis.
La ministre a rappelé le besoin de mettre en place un mécanisme d’activité partielle de longue durée après accord des partenaires sociaux. Pour en définir les curseurs, la concertation avec les partenaires sociaux devra aboutir dans les 8 jours. Il faudra aussi définir les conditions de la pérennité de l’activité partielle (niveau, date …).
Concernant l’emploi des jeunes, une concertation devra permettre d’aborder les nombreux sujets : stages, primo demandeurs, saisonniers ….
La ministre du Travail a rappelé que le temps de chômage partiel doit être utilisé pour former les travailleurs. La formation doit être orientée vers les secteurs où il y a des besoins comme les services à la personne. Elle a aussi dit avoir une vigilance particulière à poursuivre les actions sur l’insertion.
Le débat sur les travailleurs détachés doit être mené au niveau européen pour que le coût soit le même en intégrant non seulement le salaire mais aussi la protection sociale.
Le Covid-19 sera reconnu comme une maladie professionnelle pour le personnel soignant et des EHPAD. Pour les autres travailleurs, il sera mis en place un système de reconnaissance individuel par les comités régionaux des maladies professionnelles qui entraînera une prise en charge pour le salarié qui aurait subi une perte de revenu ou aurait des séquelles, ou pour ses ayants droits en cas de décès.
Une nouvelle réunion est fixée lundi pour aborder les sujets emploi.
Le ministre de l’économie et des finances a dit qu’il resterait vigilant quant à la situation des entreprises. L’activité du site Maubeuge de Renault sera maintenue. Pour soutenir l’activité, différents plans de filières seront déployés (tourisme, automobile, aéronautique …) et des mesures spécifiques pour les indépendants seront prises. Cet investissement s’élèvera à 40 milliards d’euros.
Le financement européen pour la France sera présenté mercredi. A la rentrée, le gouvernement présentera un plan de relance et les partenaires sociaux seront associés aux choix qu’il faudra faire pour soutenir l’économie française.
Le ministre de l’économie et des finances a souligné quelques objectifs : décarbonisation de l’économie pour une relance verte, meilleure coopération entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants, relocalisations tout en restant compétitifs.
Le Premier ministre, a salué le travail des agents qui a permis à l’Etat de s’adapter. Il a rappelé la gravité de la situation : même si le redémarrage était rapide il y aura des dégâts. Il faut réagir vite. Le Premier ministre a dit que les solutions de cette crise n’étaient pas purement françaises. Nous devons prendre en compte des contraintes qui vont continuer à s’exercer : la compétitivité, le financement dans la durée, les relations commerciales. Il a terminé en disant que tous doivent être dépositaires de l’intérêt général.
Le Président de la République a conclu cet échange en précisant que nous sortons de la phase de résistance au choc pour entrer dans une phase de résilience et de reprise perturbée par de nouvelle règles et de nouveaux comportements. Sans savoir combien de temps durera cette phase, il faudra limiter les faillites et maintenir l’emploi et les compétences. Il faut, dans les 15 jours, équilibrer l’activité partielle de longue durée et maintenir l’activité partielle classique dans certains secteurs. Il faut trouver les bons outils pour les branches et les entreprises, favoriser le dialogue et construire la confiance. Il faut bâtir des solutions pour les jeunes. Un nouveau rendez-vous doit être fixé dans 15 jours pour mettre en oeuvre ces dispositifs.
Sur le plan de relance, le Président de la République a exprimé sa volonté d’avancer vers plus de souveraineté économique (industrielle, alimentaire …). Il a exprimé une ambition écologique qui questionne notre modèle de production.
Au vu des changements profonds à venir, le Président a dit la nécessité de dialogue permanent.
Journée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

Journée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

Organisation de la protection sociale
Lire l'article
TEMPS DE LECTURE : 8 minutes
Confédération, fédérations et URI, Ferpa. Le Conseil national confédéral s’est déroulé en visioconférence le 14 mai.
Y participaient : Nicole Chauveau, Dominique Fabre (membre du BN), Marie-Solange Petit, Benoit Prince, Yves Vérollet.
Vous lirez ci-après l’intervention de l’UCR
Intervention de l’UCR CFDT au conseil national confédéral le 14 mai 2020 par Dominique Fabre, secrétaire générale
C’est notre premier CNC confiné. Cette situation est révélatrice, si besoin était, des fractures multiples qui existent au sein de notre société.
Les personnes très âgées à domicile ou en Ehpad ont été cruellement touchées. Le virus a touché tout le monde mais en proportion, il a été fatal avant tout aux plus âgés. 92% des décès ont concerné des personnes de 65 ans et plus ; 75% des décès ont touché des personnes de plus de 75 ans. Et ce, en raison d’un taux de létalité bien plus élevé chez les 80 ans et plus (entre 8% et 13% selon les études) alors qu’il est de moins de 1% chez les personnes âgées de moins de 60 ans.
Ce virus a également mis en exergue de nombreuses inégalités sociales
En effet, si certains ont pu rejoindre leurs résidences secondaires ou en profiter pour se retrouver en famille, d’autres sont restés confinés dans les logements exigus : selon une étude de 2016, plus de 5 millions de personnes vivent dans un logement sur-occupé, c’est-à-dire qu’elles résident à deux ou plus dans un logement où le nombre de pièces est insuffisant au regard de la taille du foyer.
Alors que certains souffrent d’une grande promiscuité au sein de leur logement, d’autres Français sont touchés par l’isolement. C’est le cas de 10,5 millions de personnes dont près d’un quart est âgé de 75 ans et plus. Cette situation n’est pas sans conséquence sur le moral mais aussi sur la santé. Les personnes âgées vivant seules représentent une part importante de la population dans les territoires ruraux. Par ailleurs, 13,3 % des personnes de 75 ans ou plus et vivant seules, résident dans une commune dépourvue de tout commerce alimentaire généraliste.
Cette période de confinement que nous avons vécue montre que les outils numériques peuvent permettre de conserver un lien social, on l’a vu notamment dans des Ehpad pour maintenir les liens familiaux. Mais il ne faut pas oublier les 12 % des Français qui n’ont pas accès à Internet à leur domicile. Cette fracture numérique est plus marquée pour les personnes plus âgées : 53 % des 75 ans ou plus n’ont pas Internet.
Cette fracture numérique a été vite perçue par certaines de nos UTR qui nous ont alertés. Par exemple, le formulaire papier de déclaration des revenus 2019 envoyé aux retraités n’ayant pas accès internet ne permet pas de bénéficier du crédit d’impôt lié à la cotisation syndicale. Il faut imprimer un autre formulaire… C’est ubuesque.
Maintenant l’heure est au déconfinement
Cette préparation ne doit en aucun cas être escamotée. Il faut lui donner le temps nécessaire.
Nous ne devons pas subir mais reprendre collectivement le contrôle de la situation, la maîtrise de notre vie sociale et citoyenne.
Il faut contrebalancer la méfiance de la population envers les discours politiques et administratifs, en tenant un discours clair, sans dissimuler les réalités de la situation, sans masquer ni les manques, ni les pénuries, ni les incertitudes pour mobiliser de façon éclairée les différents acteurs et la population.
Il faut notamment préparer à l’incertitude, à l’anticipation d’une possible deuxième vague et donner les moyens pour cela. Les difficultés de mise en œuvre du déconfinement s’avèrent en effet exceptionnelles. Elles soulèvent des questions qui intègrent la dimension scientifique mais la débordent largement. Sortir du confinement exige de trouver des équilibres entre de multiples contraintes et de multiples exigences, par exemple entre liberté individuelle et protection collective, entre impératif de santé et nécessité économique. Pour être acceptables et acceptés par la population, ces équilibres doivent se construire nationalement, mais aussi régionalement et au plus près de territoires, dans le cadre de débats démocratiques.
Les personnels du maintien à domicile et du médico-social ont été oubliés dans les premières semaines de l’arrivée de cette épidémie. Les critiques ont fusé en direction des Ehpad, c’est faire peu de cas de l’engagement des personnels. Un bilan devra être fait et les leçons devront en être tirées au moment opportun. Il a fallu cette pandémie pour reconnaitre le rôle des personnels en Ehpad et leur accorder de la considération. Leur octroyer une prime c’est bien, valoriser leurs métiers c’est mieux. Espérons au demeurant que pour les aides à domicile, Etat et département s’entendent pour qu’elle leur soit versée.
L’après Covid-19
Aujourd’hui, le discours ambiant porte sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire et sociale.
Le Gouvernement parle de relance économique mais très peu des inégalités territoriales ou de revenus. Notre valeur de solidarité est plus que jamais pertinente et toutes les couches sociales devront y participer.
Beaucoup voient déjà le monde d’après comme celui d’avant, c’est plus facile ! L’Europe a un grand rôle à jouer. Elle a commencé à le jouer via l’action de la BCE qui va éviter l’effondrement inévitable d’une bonne partie des pays de l’UE. Le Green Deal européen et le rôle de la CES demeurent un espoir pour beaucoup.
Une autre réflexion doit être menée : celle de l’éthique au sens plein du terme.
L’éthique, ce n’est pas la morale. C’est réfléchir sur les comportements à adopter pour rendre le monde humainement habitable.
L’éthique, c’est comment adapter notre économie face au risque climatique.
L’éthique, c’est comment adapter l’organisation du travail pour que tous les travailleurs aient un emploi.
L’éthique, c’est adapter le partage des richesses pour lutter contre la pauvreté et le mal logement. L’éthique, c’est adapter nos modes de production industrielle ou alimentaire au besoin de tous en respectant notre environnement.
L’éthique, c’est aussi réfléchir à rendre le monde plus habitable pour les vieux et à un meilleur accompagnement de la fin de vie.
Cette proposition de l’UCR pour une réflexion éthique en faveur des questions liées au Grand âge a été plébiscitée par plus de 98 % des votants lors de la consultation publique organisée par le Collectif « des États Généraux de la Séniorisation ».
Dans la période, les personnes âgées ont payé et paient encore un très lourd tribut face au Covid-19. Dans le même temps, des dirigeants politiques de tous bords se positionnent clairement sur le « dossier » du grand âge. Construire un rapport de force, un lobbying au bon sens du terme, est donc nécessaire pour que les avancées amorcées avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement puissent se poursuivre par un nouveau texte. C’est la raison pour laquelle l’UCR a rejoint le collectif « Etats généraux de la séniorisation » lancé par Serge Guérin.
C’est une opportunité car la situation économique à venir ne favorisera pas l’émergence de nombreuses réformes. Cependant, dans ce contexte, s’il en est une qui pourrait voir le jour, c’est la loi Grand âge.
Pour l’UCR, notre revendication phare persiste, et elle a pris toute son ampleur au cœur de cette pandémie : Avoir enfin une vraie loi pour l’accompagnement du Grand âge. Une autre revendication s’impose : avoir un interlocuteur politique concrétisé au minimum par un secrétariat d’Etat dédié aux retraités et personnes âgées.
Nous en avons assez de voir tous ces lieux, ces réunions, ces colloques où on parle des personnes âgées mais où aucune personne âgée, aucune association de personnes âgées ou aucun représentant de syndicat de retraités ne sont présents. On parle des vieux comme une entité. Il y a autant de différence chez les personnes âgées que dans le reste de la société. Cette non-représentation est infantilisante. Elle est vécue comme une forme de discrimination pour de nombreuses personnes âgées.
En savoir plus AdhérerJournée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

ANNULATION DU SEJOUR A OBERNAI

VVF Villages nous informe qu’en raison de la pandémie, le séjour prévu à Obernai en Alsace du 20 au 27 juin 2020 est annulé.
Le bureau de l’Association a pris acte de cette décision. Chaque participant sera averti individuellement.
Bien entendu, la réunion de préparation à ce séjour, prévue le mardi 26 mai prochain est annulée.
Le bureau regrette cette décision indépendante de sa volonté et souhaite que l’année 2021 permette l’organisation d’un nouveau voyage.
Jean-Paul BOURDET
En savoir plus AdhérerJournée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

Journée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

L.BERGER DANS LE TELEGRAMME DU 12 MAI 2020 :
« IL FAUT REPENSER L’ORGANISATION DU TRAVAIL «
» AUCUNE REMISE EN CAUSE DES 35 HEURES «

Rejetant toute remise en cause des 35 heures, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelle les entreprises à réinventer leur organisation. Il va faire ce mercredi des propositions pour encadrer le télétravail.
Pourquoi avoir jugé « irresponsable » l’action en justice de la CGT contre la réouverture de l’usine Renault de Sandouville ?
Comment jugez-vous les efforts déployés par les entreprises pour protéger la santé des salariés qui reprennent le travail cette semaine ?
C’est très divers. Il y a des entreprises où cela se passe bien, comme Toyota à Valenciennes, où du temps a été consacré pour débattre, redémarrer progressivement la production avec les bonnes protections individuelles, définir une nouvelle organisation du travail. Par contre, là où la reprise du travail s’est faite sans dialogue social comme chez Amazon, les salariés ont le sentiment de ne pas être correctement protégés.
La déclaration sur la reprise du travail cosignée avec le Medef était-elle utile ?
La reprise d’activité doit se faire dans le dialogue avec les salariés et avec pour priorité de bonnes conditions sanitaires. C’était important pour nous d’associer le Medef à ce constat pour engager tous les acteurs des entreprises. La reprise est absolument nécessaire malgré l’épidémie : personne ne peut penser que les entreprises peuvent fonctionner encore longtemps sans production, avec ses salariés payés par l’État.
Malgré un dialogue social au plus près de la réalité, la CGT a attaqué sur une question de procédure. La conséquence, c’est un arrêt de l’usine et 700 intérimaires qui se retrouvent chez eux. Le rôle d’une organisation syndicale est de défendre la santé des travailleurs et aussi le maintien de leur emploi. La reprise à Sandouville a reçu l’accord de trois organisations syndicales sur quatre. Qui a brisé l’unité ? Pas moi.
Vous avez été pris à partie sur les réseaux sociaux par une autre fédération de la CGT. Comptez-vous porter plainte ?
Je ne porterais pas plainte car je n’ai pas de temps à perdre sur ces bêtises indignes. Je ne confonds pas cet acte avec la CGT dans son ensemble et ses militants, que je respecterai toujours. Mais ce qui s’est passé est absolument intolérable, à l’égard de toutes les personnes que cela a pu blesser car cela avait un fort relent homophobe, à l’égard de tous les militants de la CFDT, qui se sentent visés. Et à mon égard, enfin, car j’ai une famille et j’ai le droit au respect de mon image. Cette InfoCom’CGT cherche la provocation et à nuire. J’en ai parlé à Philippe Martinez (le secrétaire général de la CGT, NDLR) qui a obtenu que les messages soient retirés.
Comment analysez-vous le recours massif au télétravail ?
C’est un appel à repenser l’organisation du travail, sûrement pas à tout transformer en télétravail. Nous avons chacun besoin de lien social dans le travail. Le télétravail devra de toute façon être encadré. La CFDT fera des propositions dès cette semaine. Par exemple, pour qu’il puisse être envisagé autrement qu’au seul domicile du télétravailleur, pour que des formations spécifiques au télétravail puissent être créées, y compris pour les managers. L’employeur doit aussi pouvoir fournir les outils informatiques adaptés.
Que répondez-vous au Medef, qui plaide pour une augmentation du temps de travail afin de relancer l’économie ?
On voit bien monter la volonté de remettre en cause la durée légale du travail à 35 heures. Cela va être un combat et la CFDT le mènera. Il peut y avoir, dans les entreprises, des accords pour faire face à la situation. Mais toute mesure globale qui augmenterait la durée du travail serait dangereuse et totalement inappropriée aux enjeux à venir. Le pays est déjà fracturé de multiples tensions et il doit faire face à une crise sans précédent, puisqu’on s’attend à plusieurs centaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Faire croire qu’on s’en sortira demain avec de la sueur et des larmes est totalement irresponsable. L’objectif demain est de travailler tous et de travailler mieux. À travers cette crise, les employeurs devront comprendre qu’il faut inventer de nouvelles organisations du travail. Remettre en cause le temps de travail ne correspond pas au « se réinventer » qu’a exprimé Emmanuel Macron.
Comment jugez-vous le climat social ?
Il y avait déjà beaucoup de défiance avant le confinement. Pour restaurer la confiance, il faut que l’on puisse fixer de nouveau de grands principes communs. Il est essentiel que puisse se tenir la conférence sociale et environnementale que la CFDT a proposée avec les autres acteurs du « Pacte pour le pouvoir de vivre ». Pour réinventer ce qu’on a envie de faire demain, il faut associer chacun, y compris dans les territoires. Il faut sortir des logiques financières pour travailler mieux, vivre mieux et être plus apaisé les uns avec les autres.
En savoir plus AdhérerJournée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !

Journée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !


La CFDT partie prenante du collectif pour défendre la fermeture du bureau de poste de Rezé Principal
Lire l'article
Journée détente pour nos adhérent(e)s SSR 3 C 44 à Clisson LA SSR 3 C...
Des envies de sorties ? Des découvertes à faire en groupe ? De la bonne humeur assurée...
L’assemblée Générale de l’ULRAN (Union Locale des Retraité·es CFDT de Nantes et alentours) s’est tenue...
Trois rendez-vous CFDT, temps forts de notre syndicat, ont eu lieu en octobre avec nos...
Ce vendredi 5 septembre 2025, les membres du bureau de Loire Atlantique se sont retrouvés...
Je m'inscris à la lettre d'information
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !